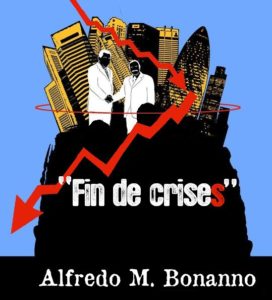Le capitalisme actuel a changé l’ensemble de la réalité économique. Le vieux monde régi par les lois et les règles rigides où les entreprises individuelles étaient en mesure de faire des projets à long terme s’est transformé en un capitalisme qui est tout à fait dépourvu de règles ou de lois prédéterminées, où pour survivre les entreprises doivent développer la flexibilité et l’adaptabilité à un degré maximum.
Les structures révolutionnaires, même anarchistes, ont également été affectées et façonnées par la dure réalité économique. Désormais, à un moment où de profonds changements technologiques ont mis la production dans un état proche du «chaos», nous nous demandons si ces vieilles théories révolutionnaires sont toujours valables. Je ne pense pas que nous puissions dire qu’elles le sont.
Un regard porté sur quelques-unes des vieilles certitudes :
Une chose qui peut être comprise à partir des quelques analyses très élaborées en circulation, est le rôle différent qui est attribué à la notion de «crise économique» dans le sens le plus large du terme.
Même dans les dernières années il y a eu encore beaucoup de discussions dans les milieux marxistes à propos d’un «développement objectif de la crise», et les diverses stratégies et organisations elles-mêmes se sont fondées sur cette conviction. Non seulement ils ont prédit le moment de vérité révolutionnaire avec l’ennemi de classe, mais ils sont même allés jusque dans les détails qui relient la fonction stratégique du parti révolutionnaire et le choix «gagnant» de la lutte armée généralisée au cours du développement prétendument objectif de la «crise».
Nous savons que les choses ne fonctionnent pas ainsi. Mais les événements qui ont conduit à ce qui précède l’actuelle défaillance ne mérite pas sérieusement débat. Tout celà pourrait se résumer à un volte-face en perspective à la suite de quelques banals problèmes de comptabilité. Les choses n’ont pas fonctionné comme prévu (mais partant d’une telle prémisse, comment aurait il peu en être autrement ?), de sorte qu’ils en sont venus à la conclusion que le mécanisme objectif n’avait pas «fonctionné», comme si il avait dû. D’autres même, se sont convertis à la collaboration de classe [et au travaillisme], révélant ainsi que les limites mentales d’aujourd’hui sont identiques à celles du passé. Il se trouve juste que les premières ont été cachées par un écran de fumée, de nouveaux slogans et quelques idées préconçues.
La complexité de la question de la «crise»
Il est un fait de notoriété publique que les marxistes ont également fait usage de ce concept de crise sous forme de consolation. À certains moments, lorsque le conflit était à son plus bas niveau et que les cœurs étaient tièdes, le train-train déterministe est resté en gare. La crise a travaillé à la place des révolutionnaires, érodant le cœur de la structure économique et sociale, et préparant le terrain pour les contradictions futures. De cette façon, le militant qui a tout sacrifié à l’espoir révolutionnaire ne voit pas le sol se dérober sous ses pieds et continue dans sa lutte, pensant avoir un allié caché dans la nature même des choses.
Puis, lorsque les contradictions grandissent et que le niveau de la lutte des classes atteint devient conséquent, le déterminisme s’arrête, ou plutôt, étant de peu d’utilité, il est retiré du devant de la scène. Il est remplacé par un volontarisme opportuniste qui est capable d’enfourcher les initiatives du mouvement (ou espère l’être), les flambées soudaines de destruction et ses organisations spontanées et créatives.
Mais en dehors de l’entreprise de boutiquier avec laquelle les partisans du pouvoir s’agitent encore, le problème demeure dans toute sa cohérence.
En réalité, le cours du processus économique et social n’est pas homogène ni dans les minuties de situations spécifiques ni dans l’ensemble des grandes polarités internationales. Il y a des périodes de crise économique, aux niveaux constants de la production, un meilleur équilibre international (à la fois politique et économique) alternant avec des époques travaillées de contradictions, où l’ensemble du système semble avoir atteint un point critique.
Les économistes ont souvent parlé de «cycles», mais ils ne sont jamais d’accord sur la façon dont ceux-ci devraient être identifiés ou définis. On pourrait dire que la discussion des cycles est l’un des aspects les plus étonnants de cette pseudo-science ridicule.
Les capitalistes arriveront-ils un jour à mettre de l’ordre, soit dans la configuration économique dans son ensemble, soit dans des structures individuelles qui la composent?
La réponse est évidemment non…
Une double (et même) erreur
 Tout cela ne signifie pas que les crises existent nécessairement, et qu’il suffirait d’attendre les événements pour nous emmener à l’instant révolutionnaire de leur propre gré.
Tout cela ne signifie pas que les crises existent nécessairement, et qu’il suffirait d’attendre les événements pour nous emmener à l’instant révolutionnaire de leur propre gré.
Au contraire. Une telle théorie «révolutionnaire» va de pair avec la théorie capitaliste de «planning» (Long Range Planning, une théorie du management enseignée en école du commerce).
L’erreur fut la même dans les deux cas. On a pensé que la formation économique (et sociale) était un ensemble composite maintenue par un ensemble de lois intrinsèques, bien ordonnés dans une science exacte (l’économie) et de son de anti-chambre (la sociologie) qu’il fallait étudier et mettre en lumière, ce qui permettrait aux révolutionnaires d’une part, et aux capitalistes d’autre part d’en tirer les conclusions certaines pour que chacun puisse exposer ses stratégies à long terme.
Il est maintenant entendu que les crises n’existent pas, pas parce que le monde est en ordre parfait, mais parce qu’au contraire, il est dans un désordre complet. Le monde est constamment à la merci de turbulences qui peuvent augmenter ou diminuer, mais ne peuvent pas être considérée comme une «crise» en ce sens qu’elles ne correspondent en rien à des anomalies de la situation, mais simplement à la réalité de la configuration économique et sociale. Pour les capitalistes, le Long Range Planning est devenu obsolète au début des années quatre-vingt-dix. On pourrait dire que le concept parallèle de «crise» existe toujours pour certains révolutionnaires. L’anachronisme, comme on peut le voir, est considérable.
Il me semble qu’il serait utile d’examiner les changements de conditions de l’économie, du moins au niveau macro-économique, de manière à essayer de comprendre les profonds changements qui s’opèrent dans les analyses révolutionnaires qui ont vu les « crises » comme un concept limité, qui a rendu possible une meilleure utilisation des instruments de rupture.
Il ne fait aussi aucun doute que l’analyse anarchiste s’est également basée sur une compréhension lente, sur des apports imméritées et des cadeaux involontaires. Pendant longtemps on a pensé que les analyses économiques fournies par l’église marxiste pourrait être utilisées en éliminant tout simplement quelques-uns de ses prémisses, et sa conclusion. Cela a déjà causé suffisamment de problèmes. Il serait bon de chercher une autre solution.
Je ne crois pas qu’il soit possible d’utiliser les idées marxistes, en aucune façon – sauf peut être pour les purger leurs déterminismes dialectiques qui finissent systématiquement par les transformer en banalités indigestes.
Vers une cohabitation troublée
 La nécessité de se conformer aux prévisions de la productivité fondée (ou présumé comme tel) sur un ordre et des lois économiques a rendu la situation des grandes entreprises capitalistes (qui constituent l’élément principal de ce que nous appelons le «capital») très risquée.
La nécessité de se conformer aux prévisions de la productivité fondée (ou présumé comme tel) sur un ordre et des lois économiques a rendu la situation des grandes entreprises capitalistes (qui constituent l’élément principal de ce que nous appelons le «capital») très risquée.
De cette manière, toute variation par rapport aux prévisions a été considérée comme fausse et causée par des situations inattendues, et par conséquent la durabilité, la nature constante des événements qui ont été perçus comme « exceptionnels » leurs a échappés. Les changements dans les niveaux de la demande, la concurrence oligopolistique, la défense des marchés par les entreprises, les niveaux de prix, les changements, les coûts, les normes professionnelles, le conditionnement de l’environnement: toutes ces choses ne peuvent plus être considérés comme «des éléments de perturbation» qui contredisent les « certitudes » de la seule théorie autorisée à interpréter la réalité.
Donc, le capital s’est retrouvé face à des surprises à un niveau stratégique. Il a été confronté à des changements continuels de ses prévisions, ce qui rend de plus en plus difficile l’adaptation à la réalité économique.
Ainsi, le soupçon que tout les comportements économiques dans leur ensemble étaient «irrationnels» a commencé à se répandre.
L’intervention de l’État, en particulier à la fin de la soixante-dix, était sans aucun doute l’un des aspects qui pouvaient contribuer à un équilibre possible, mais qui à lui seul n’était pas suffisant. Aussi parce que l’intervention de l’État, visant à réduire les aspects négatifs de la «concurrence capitaliste», s’est avéré trop porté à se concentrer sur la nécessité institutionnelle du contrôle social. Fondamentalement, l’État est une entreprise économique qui tend à réduire l’ensemble économique (et social) à la réalité de la production d’un produit unique : la paix sociale.
Le Capital, se voyant reflété dans le miroir déformant des pays d’Europe de l’est, est bien conscient que la restructuration qu’a permit le capitalisme d’Etat est un mal pire encore. Cette option assure la consolidation du pouvoir, mais elle déforme par trop les aspects classiques du capitalisme, en les domestiquant dans les limites restreintes de la nécessité institutionnelle du contrôle.
Puis fondamentalement, à ce propos, toute la phase de mise en place de «l’État» comme une variable d’ajustement, qui, en termes strictement économiques a pris fin dans les années quatre-vingt, a également permit elle-même de soutenir (au moins en ce qui concerne les pays capitalistes avancés) la plus grande innovation technologique dans l’histoire: l’électronique. Ce n’est en fait rien de moins que l’élément indispensable pour vivre avec le monstre. Sa solution résident dans la réalisation du maximum de flexibilité dans les plus brefs délais.
L’effort théorique
 Les économistes ont travaillé dur. Face aux risque de se retrouver en vase clos au sein du schéma de «crise», ils se ont retroussé les manches. D’abord ils ont critiqué la théorie néoclassique de l’entreprise commerciale, puis la gestion. Ils ont essayé de pousser cette théorie plus loin vers la recherche de «l’uniformité», afin de mettre fin aux incertitudes causées par la grande multiplicité des phénomènes.
Les économistes ont travaillé dur. Face aux risque de se retrouver en vase clos au sein du schéma de «crise», ils se ont retroussé les manches. D’abord ils ont critiqué la théorie néoclassique de l’entreprise commerciale, puis la gestion. Ils ont essayé de pousser cette théorie plus loin vers la recherche de «l’uniformité», afin de mettre fin aux incertitudes causées par la grande multiplicité des phénomènes.
Ensuite, une critique de la «crise», considérée comme l’acceptation passive d’une situation anormale qui pourrait être surmonté, a été mis en avant. L’ensemble des années soixante-dix a été caractérisé par la recherche économique visant à critiquer, dans le sens «négatif» du terme, le manque de fiabilité des prévisions basées sur les théories économiques du passé (à la fois néoclassique et de gestion, celà ne fait aucune différence).
Enfin, au début des années quatre-vingt, «l’instabilité» et la relative complexité des phénomènes en vint à être reconnu comme intrinsèque à la configuration économique, et l’idée de la présence de forces contradictoires qui pourraient être mises au pas a été liquidée pour de bon.
Les économistes parlent maintenant de «non-adaptabilité». Seule une situation à court ou à très court terme en particulier devient compréhensible à l’entreprise si la réalité économique est vu comme un tout, sans aucun centre ou aucune capacité innée à instiller de l’ordre, mais comme un certain nombre de forces qui agissent sur la base des décisions qui ne peuvent pas toujours être appelées «rationnelles».
La réponse à laquelle la théorie économique en est venue pour résoudre ce problème est on ne peut plus claire. L’entreprise capitaliste ne peut faire face à une telle situation que si elle développe la flexibilité à un degré maximum. Ce n’est pas une question de «nouvelle» situation, mais de «nouvelle» façon de voir les choses. L’entreprise doit faire preuve de souplesse dans la prise de décision, dans l’organisation de la production, et dans sa capacité à s’adapter aux changements actuels dans son ensemble.
Ainsi, les entreprises se sont décentralisées, la production n’est plus conçue comme un processus rigide, et l’anomalie est devenue la règle. Le chaos est replacé dans le canon rassurant des «lois économiques».
En réalité, le chaos est resté tel quel. Ce qui a été changé, ce sont les façons de voir les choses. Le capitaliste a appris à enfourcher le monstre. Il a toujours nourri peu de scrupules et un certain courage de corsaire. Aujourd’hui plus que jamais. Aucun prêtre de l’économie ne lui chantera plus de berceuses pour le consoler. S’il veut survivre, il doit le faire dans le court terme. Le pillage et la violence sont de plus en plus utilisés à moyen et court terme. Les grand projets de planification économique, qui étaient relayées avec flatteries dans le champ social, ont été mises de côté pour de bon.
La théorie économique passée a atteint un point critique. Le modèle néoclassique qui théorisait les calculs de rationalité économique qui se confrontaient et trouvaient un équilibre naturel dans le marché a été jeté à la poubelle. La même chose vaut pour la théorie managériale qui a été fondée exclusivement sur la stabilité de l’entreprise et sa capacité de planification.
Ces vestiges du passé ont été écartées au profit de la notion de procédure par la théorie du tâtonnement (« essais et erreurs »), qui a maintenant été complètement reprise par la cybernétique. Bien sûr, ces tentatives ne sont possibles que si l’entreprise est devenue très flexible et est capable d’exercer un contrôle suffisant.
La nouvelle situation présente clairement le problème de la façon dont l’entreprise doit agir face à son incapacité à contrôler les variables externes et même un certain nombre de facteurs internes. Les composants « politiques » de l’entreprise, la technostructure telle que définie par les économistes américains de «gauche» des années soixante-dix, sont devenus des éléments incertains. Au niveau de l’analyse macro-économique, l’Etat en particulier et son influence sur l’économie perdent la détermination qu’ils exerçaient dans l’hypothèse précédente. Au niveau de la micro-analyse, les entreprises individuelles perdent leur capacité stratégique à la planification.
La nouvelle réalité est donc caractérisée par l’introduction de l’instabilité externe dans l’entreprise elle-même, une fin des relations stables entre les entreprises, les changements dans l’État des fonctions de réglementation (l’accent est mis davantage sur le maintien du consensus), et la fin des procédures fixes à l’intérieur de l’entreprise, où le concept traditionnel d’accumulation capitaliste et d’une croissance quantitative de la production tend à disparaître.
Les nouvelles méthodes sont essentiellement basées sur le principe d’accélération de la prise de décision et les nombreuses possibilités de substitution des facteurs de production. De cette façon, l’aspect managérial de l’entreprise évolue considérablement. La science de la prise de décision économique est entrain de disparaître à jamais et est remplacé par une pratique (ou si l’on préfère, un art) de données empiriques, de décisions éclectiques, habilement et impudemment soumise au profit immédiat.
Les économistes ont élaboré la théorie de la contingence, une théorie des circonstances qui lient l’entreprise à une situation externe particulière. Celle ci ne peut pas être soumise à des calculs économiques fondés sur des lois, mais seulement sur des observations dans le très court terme fondées sur des considérations empiriques, le fruit des expériences récentes qui sont également exempts de théories fondées sur la prévision à long terme.
Les rêves néo-capitalistes se sont effondrés pour toujours, et avec eux l’actuelle configuration de la grande entreprise a vu le jour. Il devient clair que l’analyse fondée sur une conception rigide de l’organisation empêche de voir la réalité économique telle qu’elle est, résultant en une insuffisance des capacités productives.
Afin de comprendre les changements qui se produisent, il est nécessaire de tourner notre attention sur quelques points essentiels concernant les vieilles analyses économiques. Par exemple, le cycle de production du produit fini, la courbe de réduction des coûts liés aux processus qui y conduisent, la concentration (à la fois des entreprises individuelles et des groupes sectoriels oligopolistiques), la taille de l’entreprise, l’idée que la petite entreprise représente la base arrière de l’économie, la fonction de l’investissement public, l’existence de noyaux de pointe des investisseurs au niveau technologique capables d’influencer l’économie de toute une région: ce sont quelques-uns des points classiques de la vision traditionnelle. Ils sont tous en voie de disparition. La conclusion est donc qu’il n’est pas possible d’élaborer une théorie générale, mais seulement des approximations dans le but de limiter les dégâts de contrastes entre la réalité extérieure et l’entreprise.
La «nouvelle» entreprise s’élabore à partir de ce mélange unique.
 Cette entreprise n’est plus centralisée et ne sert plus de point de référence à un pôle opposé à des fonctions externes et ses intérêts. La recherche, la fabrication, la distribution commerciale, la demande d’État (qui pousse à une croissance constante), la recherche de matières premières, la propagation de la propriété des biens, la croissance du pouvoir politique, etc, sont tous des éléments de la planification sur la base du positivisme « central » de l’entreprise.
Cette entreprise n’est plus centralisée et ne sert plus de point de référence à un pôle opposé à des fonctions externes et ses intérêts. La recherche, la fabrication, la distribution commerciale, la demande d’État (qui pousse à une croissance constante), la recherche de matières premières, la propagation de la propriété des biens, la croissance du pouvoir politique, etc, sont tous des éléments de la planification sur la base du positivisme « central » de l’entreprise.
L’entreprise ne prend plus une dimension d’expansion permanente, pas plus qu’elle ne se considère comme une seule unité compacte. Elle continue à se développer, mais d’une manière différente. Il est important de comprendre ce concept. La «nouvelle croissance» est basée exclusivement sur les relations que l’entreprise a avec le monde extérieur. Les accords et projets sont de plus en plus en phase avec un langage et des codes communs. Non seulement avec d’autres entreprises (limité par des frontières naturelles), mais avec l’environnement dans son ensemble, la technologie de pointe et la recherche scientifique. Ce nouveau système (avec le Japon en tête, loin devant les Etats-Unis) se transforme à partir d’un système fermé en un système-situation ou, comme il a parfois été appelé, un «système national». La situation du système fournit la technologie, le professionnalisme du travail, les services, et une capacité à surmonter et améliorer les infrastructures juridiques ainsi que le comportement matériel, social et idéologique. En un mot, il produit un environnement approprié.
Ce n’est pas l’environnement objectif que l’ancienne entreprise a tenté de soumettre en essayant de le réduire à son besoin d’ordre, mais un environnement ré-élaborée qui a été fabriqué en fonction de la nouvelle conception du développement de l’entreprise.
Ce concept devrait être gardé à l’esprit lorsque nous parlons de la «fin» de l’usine. Ce n’est pas tant une situation particulière qui a été «pulvérisée» que la situation dans son ensemble, dans toute sa complexité. En premier lieu, cela est devenu possible grâce à la présence de la technologie électronique qui a aboli la distance avec les confins de l’espace, et par conséquent aussi du temps. Travaillant désormais en temps réel, l’entreprise moderne ne nécessite plus les entrepôts et une disposition rigides de ses composantes. Elle ne nécessite plus des unités de production à mettre en place pendant de longues périodes de temps. Elle n’a même pas besoin d’investissements financiers massifs pour apporter des changements dans les lignes de production. Sa flexibilité est telle qu’elle est en croissance exponentielle, en particulier depuis que le problème clé de la main-d’oeuvre a été résolu et que le fantôme de la lutte sociale qui lui correspondait a disparu.
La multinationale que nous connaissions dans le passé a également changé. Le grand colosse auto-suffisant n’existe plus. Il n’est plus un centre capable d’imposer son développement sur l’Etat. La nouvelle multinationale est liée à l’environnement avec lequel elle inter-agit, en essayant de tourner des conditions extérieures à son propre profit. Elle ne domine plus les circuits technologiques ou le contrôle du marché. Pas une seule entreprise, peu importe sa taille, ne peut contrôler le développement de la technologie et décider de son application (ou non) aujourd’hui. La multinationale a tendance à devenir une entreprise collective supranationale. Elle se transforme en un énorme complexe d’entreprises complémentaires liées par les conditions de la technologie, de la production et des capacités individuelles à exploiter.
Révolutionnaires
Bien que cette description que nous avons faite ici n’est qu’une ébauche, elle ne peut manquer d’intérêt pour les révolutionnaires. Si la «fin» des crises signifie que le capitalisme survit en s’adaptant à la réalité économique vu comme un chaos, nous ne pouvons pas parler de programmation, de prévisibilité et de lois économiques. Nous ne pouvons pas parler de «crises » pour désigner des situations qui se produiront en notre faveur.
Nous ne pouvons même pas penser la lutte de classe comme quelque chose avec des phases alternées. Bien sûr, le choc n’est pas «constant» au fil du temps, c’est à dire qu’en son sein il y a des moments d’intensité plus ou moins grande, mais il s’agit plutôt d’une question de changements qualitatifs et quantitatifs qui ne peuvent être retracés de façon déterministe à de simples causes économiques. Une vaste imbrication des relations sociales est à la base de la lutte des classes. Aucune analyse ne peut nous donner l’aune véritable pour mesurer les attentes ou la légitimation d’un comportement. Il est toujours temps d’attaquer, même si les conséquences peuvent évidemment varier considérablement.
En ce sens, nous devons réfléchir à la possibilité de l’organisation révolutionnaire qui correspond à la réalité de l’affrontement de classe telle qu’il est aujourd’hui.
La structuration organisationnelle passée -du Parti à la fédération de groupes, du syndicalisme aux conseils de travailleurs- ont plus ou moins correspondu à une idée de la réalité économique qui a vu l’entreprise capitaliste comme son centre, le lieu de la concentration du pouvoir et de la capacité à exploiter.
On a pensé qu’une structure tout aussi monolithique (le syndicat, le parti, ou la fédération) était la façon logique de s’y opposer. Même dans le passé, quand on ne jurait que par les lois économiques éternelles, la réalité productive était en fait chaotique et on a été systématiquement pénalisé lorsque l’approche se faisait dans le mauvais sens. Peut-être que les concepts même de «cycles économiques» et des « crises »doivent être considérés sous cet angle.
Donc, nous avons des changements dans la réalité de la production, mais surtout nous avons une manière différente de regarder cette réalité. Il est donc une fois de plus grand temps de développer une manière différente de regarder la réalité à partir d’une perspective révolutionnaire. Je dis une fois de plus, parce que, en particulier pour les anarchistes, une critique radicale n’est jamais un luxe, surtout quand nous nous opposons aux concepts monolithiques et quantitatifs de l’anarcho-syndicalisme et les ambitions de partis quasi-politiques des grandes fédérations anarchistes.
 Une structure organisationnelle différente est en grande partie encore à être pensée et réalisée, mais n’a certainement pas besoin d’être redécouverte. Toute tentative de ressusciter les cadavres des derniers processus organisationnels doit contenir des précisions quant à la façon dont ils ont face à une activité économique (et sociale) dans une réalité qui devient de plus facile à comprendre en termes d’indéterminisme, et certainement pas par des lois économiques rigides. Chaque fois que cette explication est tentée, à chaque fois que des propositions organisationnelles révolutionnaires commencent à se lier aux images du passé (les partis, les fédérations, les groupes, le syndicalisme, etc…), nous voyons comment la conception commune de la réalité économique est liée à l’hypothèse de l’existence de lois. Chaque fois que ces lois sont prises pour acquis, ou sont timidement cachées entre les lignes, la foi dans le principe des cycles économiques de crises vient à l’esprit. Et cette foi, comme tout les autres, se révèle être bien pratique dans les moments difficiles.
Une structure organisationnelle différente est en grande partie encore à être pensée et réalisée, mais n’a certainement pas besoin d’être redécouverte. Toute tentative de ressusciter les cadavres des derniers processus organisationnels doit contenir des précisions quant à la façon dont ils ont face à une activité économique (et sociale) dans une réalité qui devient de plus facile à comprendre en termes d’indéterminisme, et certainement pas par des lois économiques rigides. Chaque fois que cette explication est tentée, à chaque fois que des propositions organisationnelles révolutionnaires commencent à se lier aux images du passé (les partis, les fédérations, les groupes, le syndicalisme, etc…), nous voyons comment la conception commune de la réalité économique est liée à l’hypothèse de l’existence de lois. Chaque fois que ces lois sont prises pour acquis, ou sont timidement cachées entre les lignes, la foi dans le principe des cycles économiques de crises vient à l’esprit. Et cette foi, comme tout les autres, se révèle être bien pratique dans les moments difficiles.
En soumettant les modèles économiques du passé à une critique radicale, nous mettons en doute les convictions du présent (d’ailleurs, vacillantes) concernant les structures organisationnelles des mouvements révolutionnaires en général et de l’organisation anarchiste en particulier.
Mais, comme nous le savons, les révolutionnaires ont tendance à être plus conservateurs que les Conservateurs.
Traduit par Le Cri Du Dodo
[Titre original: La “fine” della crisi, paru dans “Anarchismo”, no. 57, 1987. Traduction en anglais par Jean Weir et publié sous le titre dans “Let’s destroy work, let’s destroy the economy” Elephant Editions, Londres.]